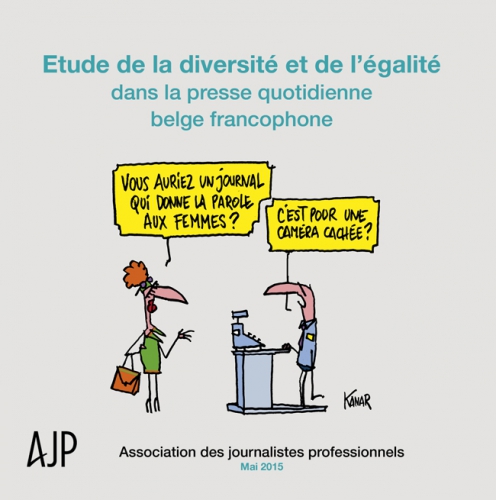Le retour du beau temps estival m’a fait prendre des libertés avec mon rythme habituel, voici un billet de week-end qui s’était endormi à l’ombre !

© Taf Wallet, La lecture sur la plage
Dans La Libre Belgique du 21 août dernier, deux textes rejoignent certaines réflexions dont je me suis déjà fait l’écho ici. D’abord, aux pages Débats, une « opinion » d’Aymeric de Lamotte intitulée « Revisiter notre rapport au voyage ». En voici le chapeau : « Redécouvrir ce qui nous est proche géographiquement ne permet pas seulement de préserver l’environnement : il s’agit de renouer avec un monde tangible, palpable, enraciné. »
Mona Chollet a parlé des « vertus surestimées du mouvement perpétuel » dans Chez soi. Ici, l’auteur s’interroge à partir du nouveau record de notre aéroport national pour le nombre de passagers accueillis durant le premier trimestre de cette année. « Aller loin » est devenu la norme en matière de voyage, beaucoup cherchent un « changement radical de continent, de climat, de décor ».
Il déplore que, trop souvent, « nous ignorons notre propre géographie, notre histoire et nos semblables ». L’espace « enjambé » compterait davantage que « la qualité des échanges humains », l’approche physique de la nature, la découverte culturelle. Non qu’il faille se détourner de l’ailleurs, mais nous y perdrions le goût et la curiosité pour ce qui est proche de chez nous.
Je ne partage pas forcément son analyse sous l’intertitre « La question du sens », mais j’y ai trouvé un bel éloge de la marche et du vélo pour se déplacer, des notions de hasard, lenteur, contrainte, simplicité au cœur de l’expérience du voyage. Est-ce que « l’aventure locale et charnelle approfondit la connaissance de nous-mêmes, l’attachement à notre environnement, et facilite notre aptitude au bonheur » ? Dans une certaine mesure, oui, comme le montre Anne Le Maître dans Sagesse de l’herbe.
Le texte se termine sur une « inquiétude écologique » face à la manière consumériste de voyager en sautant dans des avions et en collectionnant les destinations. Le tourisme de masse est devenu un fléau, pour les habitants locaux et pour la planète. J’ajouterai que la vogue du partage de photos en ligne dont a parlé Adrienne et le succès des influenceurs rétribués pour renouveler le langage publicitaire encouragent cette fuite en avant.
L’article suivant, « Voyage dans ma rue », une chronique de Florence Richter, est une invitation sympathique à l’art de « redécouvrir de temps en temps son chez-soi ». Elle a passé le mois de juillet à Bruxelles et est partie à l’aventure dans son quartier. Observations, sourires entre passants, découverte d’un petit parc public très paisible derrière une résidence pour seniors, fresques urbaines, il y a tant à voir quand on prend le temps de regarder. De quoi inciter au « vagabondage à pied sans but et sans raison », une autre façon de vivre ses vacances.
Passons aux pages Culture de La Libre qui suivent. J’y apprends que le dernier roman d’Amélie Nothomb parle de Jésus : « L’Evangile selon Amélie Nothomb : étonnant et formidable » titre Guy Duplat en haut de cet entretien très intéressant qui se termine sur un éloge de la solitude. « C’est essentiel de trouver des moments de solitude. Proust écrivait que la solitude est un état de profondeur dont on ne peut jamais se passer. Et la lecture y aide. » (Amélie Nothomb)